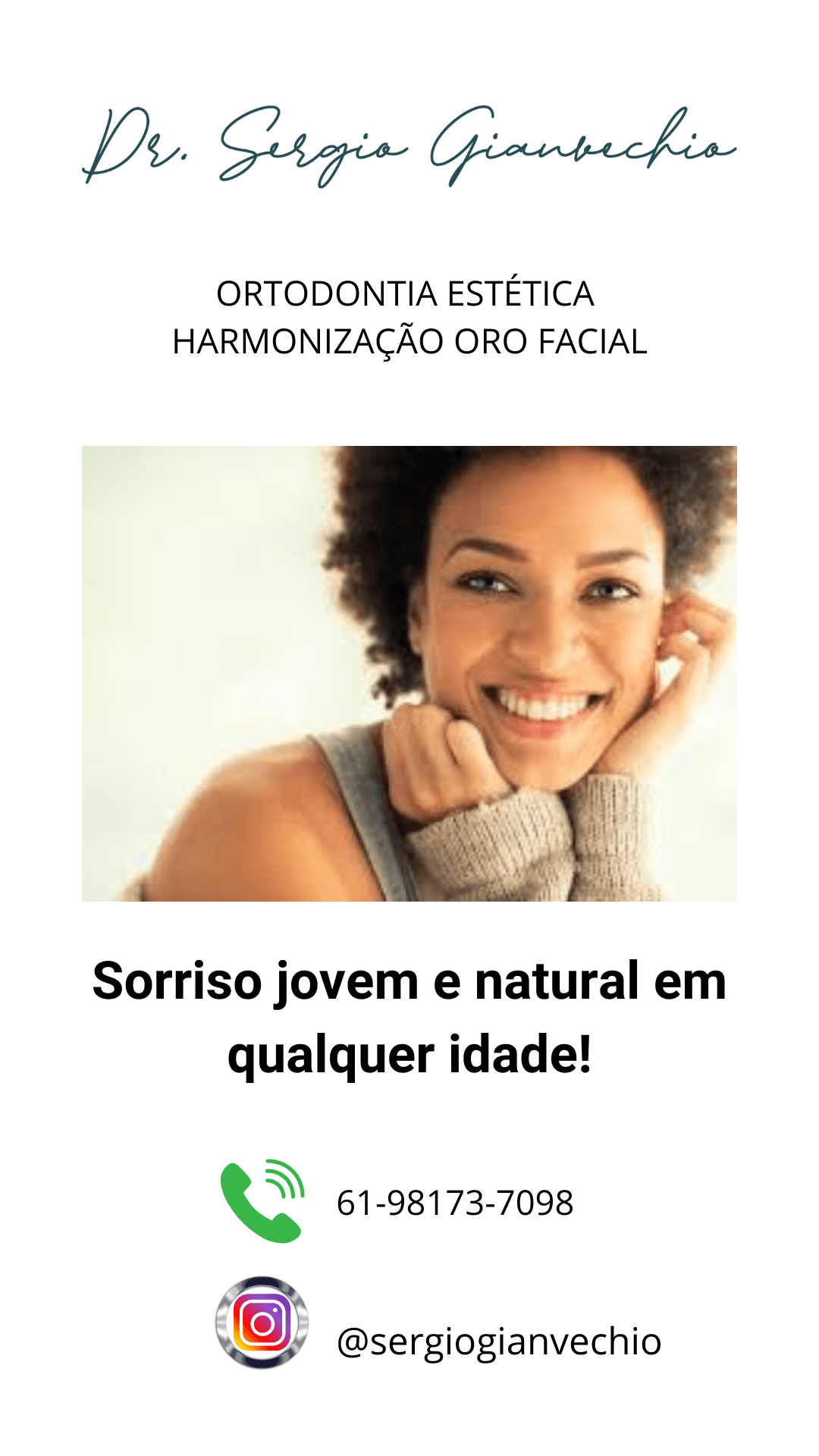L’étiquetage dans l’étude de la neuropsychologie peut avoir des effets négatifs profonds, à la fois sur le développement de l’individu et sur la perception de la société.
En juillet 2024, il me reste moins de deux mois avant de terminer 21 ans au Brésil en tant que pédagogue rééducateur, mettant en œuvre un modèle de soins pour les adolescents délinquants. Cette expérience est basée sur le principe de la reconnaissance de l’être humain et de l’inclusion, en évitant le risque sérieux d’étiquetage que l’étude et l’application de la neuropsychopédagogie peuvent entraîner.
L’étiquetage dans l’étude de la neuropsychologie peut avoir des effets négatifs profonds, à la fois sur le développement de l’individu et sur la perception de la société. En étiquetant une personne avec un trouble ou un handicap, on risque de la réduire à cette caractéristique, en ignorant sa complexité et son potentiel. Cette simplification peut conduire à la stigmatisation, affectant l’estime de soi et les opportunités de vie de l’individu. L’étiquetage peut également influencer le comportement des professionnels de la santé et des éducateurs, qui peuvent adopter des attentes limitées, renforçant ainsi un cycle de sous-performance et de marginalisation.
Le danger de l’étiquetage
L’étiquetage d’un individu avec un diagnostic neuropsychologique, bien qu’il puisse être utile pour cibler les interventions et le soutien, a souvent des conséquences négatives. Tout d’abord, l’étiquetage peut masquer l’identité multiforme de l’individu. Par exemple, un enfant diagnostiqué avec un TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité) ne peut être vu qu’à travers ce prisme, sans tenir compte de ses capacités, de ses intérêts et d’autres aspects de sa personnalité. Cette vision limitée peut conduire à une compréhension superficielle de l’individu, ignorant son potentiel et sa capacité d’adaptation.
En outre, l’étiquetage peut générer un effet de prophétie auto-réalisatrice. Les éducateurs et les professionnels de la santé qui pensent qu’un enfant est limité par son diagnostic peuvent inconsciemment réduire leurs attentes et leurs possibilités de développement. Il peut en résulter un cercle vicieux dans lequel l’enfant intériorise ces attentes réduites et, par conséquent, limite ses propres performances. Des études montrent que les faibles attentes des enseignants peuvent entraîner une baisse des résultats scolaires des élèves, quelles que soient leurs capacités réelles.

Stigmatisation et estime de soi
Un autre effet négatif de l’étiquetage est la stigmatisation. La société a tendance à réagir négativement aux diagnostics neuropsychologiques, les associant souvent aux préjugés et à la discrimination. Les personnes étiquetées peuvent être victimes de brimades, d’isolement social et de rejet à l’école et dans la communauté. Cette différence de traitement peut avoir un impact profond sur l’estime de soi et le bien-être émotionnel de l’individu.
L’estime de soi est une composante essentielle d’un développement sain. Les personnes qui se sentent valorisées et acceptées sont plus susceptibles de s’épanouir dans divers domaines de la vie. Lorsque l’étiquetage entraîne une stigmatisation, l’estime de soi peut être gravement compromise, entraînant des problèmes de santé mentale tels que l’anxiété, la dépression et, dans les cas extrêmes, des comportements d’automutilation. Le manque de soutien social et le sentiment d’être différent ou inférieur peuvent exacerber ces conditions, créant des obstacles supplémentaires au développement personnel et à l’intégration sociale.
Des attentes limitées et un cycle de sous-performance
Les professionnels de la santé et les éducateurs jouent un rôle fondamental dans la définition des attentes et des possibilités des personnes atteintes de troubles neuropsychologiques. Cependant, lorsque ces professionnels adoptent une vision restrictive basée sur des étiquettes, ils peuvent involontairement limiter le potentiel de croissance et de développement de l’individu. Des attentes limitées peuvent se manifester par des pratiques éducatives inadéquates, où l’accent est mis uniquement sur l’adaptation aux difficultés plutôt que sur le développement des capacités et des intérêts de l’individu.
Ce cycle de sous-performance peut être difficile à briser. Lorsqu’une personne est constamment traitée sur la base de ses limites, elle peut intérioriser ce point de vue et croire qu’elle n’est pas capable d’accomplir davantage. Cette intériorisation peut conduire à un manque de motivation, à une faible confiance en soi et à une réduction des efforts pour relever les défis. En conséquence, l’individu peut finir par répondre aux attentes limitées qui lui sont imposées, perpétuant ainsi le cycle de la sous-performance et de la marginalisation.
Promouvoir l’inclusion et une vision positive de l’être humain
Pour lutter contre les effets négatifs de l’étiquetage, il est essentiel d’adopter des approches centrées sur la personne qui valorisent les forces et les capacités individuelles. Au lieu de se concentrer uniquement sur les limitations, il est nécessaire de reconnaître et de promouvoir les capacités et les talents de chaque personne. La promotion de la neurodiversité, par exemple, est une approche qui célèbre la variété des fonctions cérébrales et cognitives, reconnaissant que chaque individu apporte une contribution unique à la société.

Approches centrées sur la personne
Les approches centrées sur la personne impliquent de considérer l’individu dans sa globalité, plutôt qu’un ensemble de symptômes ou de limitations. Il s’agit notamment de comprendre leurs expériences, leurs intérêts, leurs valeurs et leurs objectifs, et d’utiliser cette compréhension pour informer les interventions et les soutiens. Dans les contextes éducatifs, cela peut signifier adapter les programmes et les méthodes d’enseignement aux intérêts et aux points forts des élèves, plutôt que de se concentrer sur les domaines dans lesquels ils ont des difficultés.
En outre, les approches centrées sur la personne soulignent l’importance de la participation active de l’individu à son propre processus de développement. Cela peut impliquer la fixation conjointe d’objectifs, où l’individu a son mot à dire dans la détermination de ses objectifs et des méthodes pour les atteindre. Cette participation active peut accroître la motivation, le sentiment d’appropriation et la confiance en soi, favorisant ainsi une croissance plus significative et durable.
Promouvoir la neurodiversité
La promotion de la neurodiversité est une stratégie efficace pour favoriser l’inclusion et une vision positive de l’être humain. La neurodiversité reconnaît que les variations des fonctions cérébrales et cognitives sont naturelles et doivent être célébrées, plutôt que d’être considérées comme des anomalies à corriger. Cette perspective remet en question la vision traditionnelle qui pathologise les différences neuropsychologiques, en promouvant une culture d’acceptation et d’appréciation de la diversité.
L’éducation à la neurodiversité peut contribuer à réduire les stigmates et les préjugés associés aux diagnostics neuropsychologiques. En faisant prendre conscience de la diversité des modes de fonctionnement du cerveau, on peut favoriser une plus grande empathie et une meilleure compréhension. Cela peut conduire à des environnements plus inclusifs, où les différences sont considérées comme des forces à valoriser, plutôt que comme des faiblesses à corriger.
Sensibilisation et éducation
La sensibilisation aux effets de l’étiquetage est une autre étape cruciale dans la promotion de l’inclusion. Les professionnels de la santé, les éducateurs, les parents et la société en général doivent être informés des dangers de l’étiquetage et de l’importance d’une approche centrée sur la personne. Les programmes de formation et de développement professionnel peuvent contribuer à doter ces personnes des outils et des connaissances nécessaires pour adopter des pratiques plus inclusives et empathiques.
En outre, les campagnes de sensibilisation du public peuvent contribuer à modifier les perceptions et les attitudes à l’égard des personnes ayant reçu un diagnostic neuropsychologique. En mettant en avant les réussites et les exemples positifs, on peut combattre les stéréotypes et promouvoir une vision plus équilibrée et plus positive.

Conclusion
Je termine mon article en m’engageant à présenter des expériences réelles et appliquées de cette approche. Au cours des 21 dernières années, j’ai été le témoin direct des avantages d’une approche centrée sur la personne qui valorise la neurodiversité et favorise l’inclusion. Ces principes améliorent non seulement la qualité de vie des individus, mais renforcent également le tissu social, en créant des communautés plus empathiques et plus solidaires. Il est essentiel de continuer à remettre en question l’étiquetage et de promouvoir des pratiques qui reconnaissent et célèbrent la complexité et le potentiel de chaque être humain.